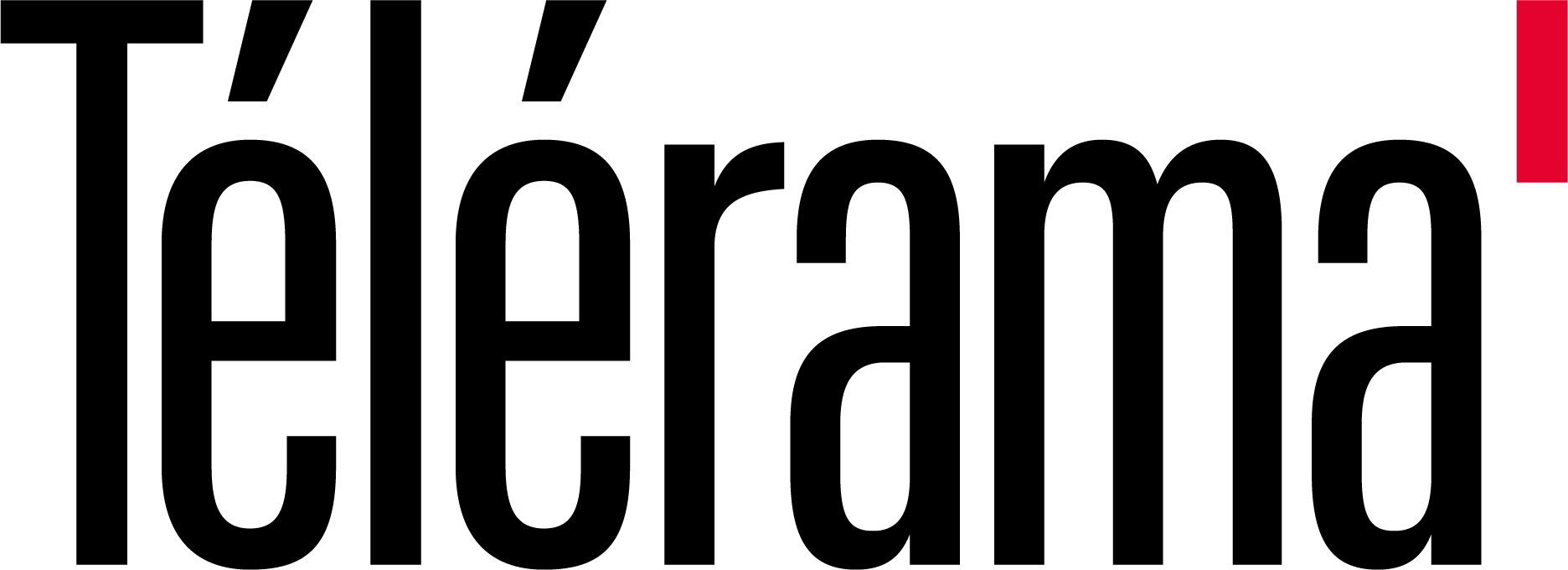Bande Annonce de l’exposition “Amazighes”


Le monde amazigh, dont les origines sont diverses et encore sujettes à débats dans la communauté scientifique, s’est déployé, depuis au moins le Néolithique, sur un large territoire depuis l’Egypte jusqu’au Maroc et même aux îles Canaries, incluant le nord du Niger, du Mali et de la Mauritanie. Il partage une identité linguistique avec le tamazight et une écriture commune, le tifinagh.
Dans le monde amazigh, toute action de parure est associée à une signification de protection et d’éternel retour. L’action de parer, orner, recouvrir, décorer, renvoie à un statut, à l’identité d’un groupe. La parure, le tissage ou la céramique, loin d’être accessoires, sont essentiels et constituent une sorte de filtre physique ou magique, un dispositif total de protection du corps, de l’espace domestique et plus largement de l’espace social global. Des corps tatoués aux bijoux, en passant par les objets domestiques, les voiles ou tendeurs de tentes, les murs ou portes de maisons, se retrouvent les mêmes motifs, formes, symboles, qui ne sont pas seulement décoratifs mais jouent un rôle triple : esthétique certes, mais aussi thérapeutique et apotropaïque, et de marqueur social et de genre. Certaines limites de l’espace social amazigh sont clairement signifiées, de diverses manières, par des paroles, des attitudes, des figurations, mais également par certains rituels spécifiques autour des seuils et des portes, car elles marquent ou établissent des frontières entre l’extérieur et le domaine du foyer, qui reste essentiellement dévolu aux femmes
Autour de l'exposition
Entretien avec Salima Naji (architecte DPLG et docteure en anthropologie) et Alexis Sornin (directeur des musées Yves Saint Laurent Marrakech et Pierre Bergé des arts berbères), commissaires de l’exposition
Le terme « amazigh » est peu connu en France, où l’on parle plutôt de culture « berbère »… Pouvez-vous nous éclairer sur ces différentes terminologies ?
Tout comme le mot « Inuit » a remplacé l’appellation « Esquimau », il s’agit pour les peuples de se nommer par des noms qu’ils ont eux-mêmes choisis afin de ne plus être le « barbare » de l’Autre. On sait que le mot « berbère » est un dérivé du mot « barbare ». Il y a donc le désir, dans une revendication décoloniale, de mieux se désigner, de mieux se connaître. Dans l’exposition, nous parlons des Amazighes, au féminin pluriel, car nous souhaitons mettre en valeur le rôle fondamental des femmes. Les déesses mères qui nous viennent des îles Canaries, avec leurs triangles gravés, montrent l’usage de ce qui s’appelle aussi la fibule : elle reprend une esthétique simple et graphique et est présente sur tous les supports, des îles Canaries à la Lybie et à l’Égypte en passant par la Sardaigne et les Açores. De la peau jusqu’aux murs, des visages aux tissages, il est question d’un même rapport au monde : face à l’aléa, face à l’incertitude, se protéger de la faim, de la soif, mais aussi de toute intention malfaisante. Protéger son foyer, protéger les siens, concilier l’environnement proche : celui qui nourrit, celui qui donne ou reprend la vie.
Comment l’oralité et l’écriture amazighes ont-elles contribué à la transmission et à l’évolution de cette culture à travers le temps ?
La culture amazighe repose largement sur l’oralité, facteur clef de sa transmission et de sa longévité depuis l’Antiquité. Cette tradition orale a permis de préserver et de transmettre les savoir-faire à travers les générations. L’exposition vise à établir un lien entre ce passé profondément enraciné et les expressions contemporaines de motifs récurrents et protecteurs, notamment à travers le travail d’artistes comme Farid Belkahia (1934–2014) et Amina Agueznay.
L’écriture amazighe, le tifinagh, se distingue par son caractère graphique et symbolique. Elle a inspiré les alphabets contemporains de l’Algérie, de la Lybie et du Maroc, tandis qu’au Niger, elle reste encore largement utilisée, notamment par des artistes comme le poète Hawad. En Algérie, les gardes forestiers des parcs du Tassili l’emploient dans leur communication quotidienne.
La diversité linguistique amazighe concerne également la diaspora. Dans notre recherche, nous avons identifié des mots « pan-amazighs » communs à l’ensemble des langues berbères.
Certains termes comme aman (eau) ou aghrom (pain) témoignent de cette unité linguistique.
L’exposition met également en lumière la Tamazgha, une vaste zone géographique où ces langues sont parlées, s’étendant des îles Canaries jusqu’à l’ouest de l’Égypte, en incluant la bande sahélienne. Autrefois traversée par des réseaux de commerce et de transhumance, cette région est aujourd’hui marquée par la présence de diasporas amazighes installées dans les grandes villes, reflet d’une histoire migratoire vieille de plus d’un siècle.
Quelles sont les pièces les plus remarquables à vos yeux au sein de l’exposition ?
Nous sommes heureux de montrer des objets venus des îles Canaries par exemple, une région si peu connue, si profondément amazighe, et dont l’histoire est si particulière. Mais dans cette exposition, nous avons surtout eu à cœur de montrer des liens. Plutôt que de nous focaliser sur telle ou telle œuvre, nous préférons montrer comment tel motif est prégnant au Maroc mais aussi en Kabylie ; comment telle gestuelle ou tel savoir-faire a donné une grammaire de formes qui habillent un tissage en Tunisie ou au Maroc, une poterie au Niger ou en Lybie. Cet héritage est incroyablement riche, et nous avons voulu en donner des clefs de lecture. Il s’agit de montrer comment celles qui mettent au monde, celles qui donnent la vie, dans des contextes difficiles, sont aussi celles qui ornent leur quotidien de soin et de beauté. Les coiffes, qui font la synthèse entre les bijoux et l’art d’orner une chevelure ou un buste, marquent le corps d’une esthétique singulière qui réhausse et protège.
Sous quelles formes la culture amazighe circule-t-elle aujourd’hui dans les cultures populaires ?
Ce que nous avons souhaité mettre en avant dans ce musée de société unique en son genre qu’est le Mucem, c’est la diversité et l’évolution des sociétés. Par le passé, les musées ont parfois fragmenté et dispersé des ensembles culturels, privilégiant une approche centrée sur la collecte des objets, ce qui a pu occulter la fluidité des pratiques vivantes. Dans le même temps, ces motifs et traditions ont été réinterprétés par des diasporas, devenant des marqueurs identitaires pour des communautés éloignées de leurs territoires d’origine.
Aujourd’hui, une modernité renouvelée s’empare de ces répertoires culturels, en les replaçant
dans une dynamique de transmission et de dialogue plutôt que dans une logique de rupture ou de disparition. Dans l’exposition, nous mettons en avant des initiatives valorisant la transmission des savoirs. À travers ses films, Myriem Naji documente et partage des techniques artisanales pour les rendre accessibles au public. Amina Agueznay collabore avec des tisseuses pour créer un répertoire de signes intégré à son œuvre. Enfin, présenter des tatouages contemporains et des écritures actuelles en résonance avec des pratiques ancestrales permet d’illustrer la continuité et l’adaptabilité de ces traditions.
Quelle a été votre principale découverte lors de vos recherches sur cette exposition ?
La complémentarité ! Préparer une exposition avec plusieurs personnes ayant des parcours différents est un bonheur, car le travail des uns éclaire celui des autres. Les collections aussi dialoguent, celles du Mucem et du musée Yves Saint Laurent Marrakech. De plus, le Mucem apporte un regard neuf sur la constitution des collections, en intégrant l’Encyclopédie berbère créée par le couple d’archéologues Gabriel (1927–2002) et Henriette Camps (1928–2015).
Nous souhaitons également évoquer la fille de Mireille Morin-Barde (1916–2002), ethnographe ayant réalisé un travail remarquable de documentation sur les coiffes et parures amazighes dans les régions présahariennes du Maroc. L’entendre se remémorer les années où sa mère rédigeait son ouvrage principal, fruit d’une enquête complexe, a été particulièrement émouvant. Son témoignage reflète l’attachement de Mireille Morin-Barde aux femmes qu’elle a rencontrées sur le terrain, ainsi que la difficulté de les retrouver dans les années 1980, trente ans après ses premières recherches. Faute de pouvoir toujours recourir à la photographie, elle a privilégié le dessin et la peinture, travaillant en étroite collaboration avec ces femmes, dans une démarche que l’on qualifierait aujourd’hui de participative et empreinte d’une éthique anthropologique encore peu répandue à l’époque.
Ces échanges et rencontres, essentiels à toute recherche, sont aussi la matière vivante qui nourrit en profondeur le travail d’une exposition.
Depuis les premiers mythes, la matrice à partir de laquelle est pensée la naissance de la culture amazigh est féminine : l’exposition s’ouvrira sur les figures fondatrices des déesses mères, associées symboliquement à la figure, féconde et protectrice, du cercle. Le parcours explorera ces notions de seuils et de cercles protecteurs, qui sont au cœur de la culture amazigh et la structurent, puis s’attachera aux objets, aux surfaces, aux formes et aux signes dans lesquels elles viennent s’incarner de façon matérielle : signes abstraits, géométriques, mais aussi figuratifs (tortue, poisson, grenouille, épi de blé
ou œil, figure anthropomorphe, etc.). L’accent sera mis sur la dimension cyclique de la nature (la lune, le retour du printemps, les moissons) en lien avec les gestes et les savoir-faire des femmes (poterie, tissage, teinture au henné, vannerie, tatouage…) mais aussi ceux des hommes pratiquant traditionnellement l’orfèvrerie
Cette exposition sera également l’occasion de s’interroger sur le concept de « permanence berbère » et sur les transmissions et circulations contemporaines de ce matrimoine/patrimoine au sein de l’importante diaspora amazigh, dans le domaine de la création artistique comme dans les cultures
populaires. Sans omettre, par ailleurs, l’appréciation voire l’appropriation culturelle dont ce matrimoine/ patrimoine peut faire l’objet aujourd’hui.
Environ 150 objets et œuvres du XIXe siècle à nos jours, ainsi que quelques pièces archéologiques, seront présentés parmi lesquels des bijoux, céramiques, textiles, vanneries, sculptures, outils, photographies, vidéos, installations, archives appartenant principalement aux collections du musée Pierre Bergé des arts berbères de la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech et à celles du Mucem, mais aussi à des collections publiques et privées canariennes, marocaines et françaises, ainsi qu’à des artistes.
Commissariat :
Salima Naji, architecte DPLG et docteure en anthropologie
Alexis Sornin, directeur des musées Yves Saint Laurent Marrakech et Pierre Bergé des arts berbères
Le monde amazigh, dont les origines sont diverses et encore sujettes à débats dans la communauté scientifique, s’est déployé, depuis au moins le Néolithique, sur un large territoire depuis l’Egypte jusqu’au Maroc et même aux îles Canaries, incluant le nord du Niger, du Mali et de la Mauritanie. Il partage une identité linguistique avec le tamazight et une écriture commune, le tifinagh.

Dans le monde amazigh, toute action de parure est associée à une signification de protection et d’éternel retour. L’action de parer, orner, recouvrir, décorer, renvoie à un statut, à l’identité d’un groupe. La parure, le tissage ou la céramique, loin d’être accessoires, sont essentiels et constituent une sorte de filtre physique ou magique, un dispositif total de protection du corps, de l’espace domestique et plus largement de l’espace social global. Des corps tatoués aux bijoux, en passant par les objets domestiques, les voiles ou tendeurs de tentes, les murs ou portes de maisons, se retrouvent les mêmes motifs, formes, symboles, qui ne sont pas seulement décoratifs mais jouent un rôle triple : esthétique certes, mais aussi thérapeutique et apotropaïque, et de marqueur social et de genre. Certaines limites de l’espace social amazigh sont clairement signifiées, de diverses manières, par des paroles, des attitudes, des figurations, mais également par certains rituels spécifiques autour des seuils et des portes, car elles marquent ou établissent des frontières entre l’extérieur et le domaine du foyer, qui reste essentiellement dévolu aux femmes

Bande Annonce de l’exposition “Amazighes”
Autour de l'exposition
Entretien avec Salima Naji (architecte DPLG et docteure en anthropologie) et Alexis Sornin (directeur des musées Yves Saint Laurent Marrakech et Pierre Bergé des arts berbères), commissaires de l’exposition
Le terme « amazigh » est peu connu en France, où l’on parle plutôt de culture « berbère »… Pouvez-vous nous éclairer sur ces différentes terminologies ?
Tout comme le mot « Inuit » a remplacé l’appellation « Esquimau », il s’agit pour les peuples de se nommer par des noms qu’ils ont eux-mêmes choisis afin de ne plus être le « barbare » de l’Autre. On sait que le mot « berbère » est un dérivé du mot « barbare ». Il y a donc le désir, dans une revendication décoloniale, de mieux se désigner, de mieux se connaître. Dans l’exposition, nous parlons des Amazighes, au féminin pluriel, car nous souhaitons mettre en valeur le rôle fondamental des femmes. Les déesses mères qui nous viennent des îles Canaries, avec leurs triangles gravés, montrent l’usage de ce qui s’appelle aussi la fibule : elle reprend une esthétique simple et graphique et est présente sur tous les supports, des îles Canaries à la Lybie et à l’Égypte en passant par la Sardaigne et les Açores. De la peau jusqu’aux murs, des visages aux tissages, il est question d’un même rapport au monde : face à l’aléa, face à l’incertitude, se protéger de la faim, de la soif, mais aussi de toute intention malfaisante. Protéger son foyer, protéger les siens, concilier l’environnement proche : celui qui nourrit, celui qui donne ou reprend la vie.
Comment l’oralité et l’écriture amazighes ont-elles contribué à la transmission et à l’évolution de cette culture à travers le temps ?
La culture amazighe repose largement sur l’oralité, facteur clef de sa transmission et de sa longévité depuis l’Antiquité. Cette tradition orale a permis de préserver et de transmettre les savoir-faire à travers les générations. L’exposition vise à établir un lien entre ce passé profondément enraciné et les expressions contemporaines de motifs récurrents et protecteurs, notamment à travers le travail d’artistes comme Farid Belkahia (1934–2014) et Amina Agueznay.
L’écriture amazighe, le tifinagh, se distingue par son caractère graphique et symbolique. Elle a inspiré les alphabets contemporains de l’Algérie, de la Lybie et du Maroc, tandis qu’au Niger, elle reste encore largement utilisée, notamment par des artistes comme le poète Hawad. En Algérie, les gardes forestiers des parcs du Tassili l’emploient dans leur communication quotidienne.
La diversité linguistique amazighe concerne également la diaspora. Dans notre recherche, nous avons identifié des mots « pan-amazighs » communs à l’ensemble des langues berbères.
Certains termes comme aman (eau) ou aghrom (pain) témoignent de cette unité linguistique.
L’exposition met également en lumière la Tamazgha, une vaste zone géographique où ces langues sont parlées, s’étendant des îles Canaries jusqu’à l’ouest de l’Égypte, en incluant la bande sahélienne. Autrefois traversée par des réseaux de commerce et de transhumance, cette région est aujourd’hui marquée par la présence de diasporas amazighes installées dans les grandes villes, reflet d’une histoire migratoire vieille de plus d’un siècle.
Quelles sont les pièces les plus remarquables à vos yeux au sein de l’exposition ?
Nous sommes heureux de montrer des objets venus des îles Canaries par exemple, une région si peu connue, si profondément amazighe, et dont l’histoire est si particulière. Mais dans cette exposition, nous avons surtout eu à cœur de montrer des liens. Plutôt que de nous focaliser sur telle ou telle œuvre, nous préférons montrer comment tel motif est prégnant au Maroc mais aussi en Kabylie ; comment telle gestuelle ou tel savoir-faire a donné une grammaire de formes qui habillent un tissage en Tunisie ou au Maroc, une poterie au Niger ou en Lybie. Cet héritage est incroyablement riche, et nous avons voulu en donner des clefs de lecture. Il s’agit de montrer comment celles qui mettent au monde, celles qui donnent la vie, dans des contextes difficiles, sont aussi celles qui ornent leur quotidien de soin et de beauté. Les coiffes, qui font la synthèse entre les bijoux et l’art d’orner une chevelure ou un buste, marquent le corps d’une esthétique singulière qui réhausse et protège.
Sous quelles formes la culture amazighe circule-t-elle aujourd’hui dans les cultures populaires ?
Ce que nous avons souhaité mettre en avant dans ce musée de société unique en son genre qu’est le Mucem, c’est la diversité et l’évolution des sociétés. Par le passé, les musées ont parfois fragmenté et dispersé des ensembles culturels, privilégiant une approche centrée sur la collecte des objets, ce qui a pu occulter la fluidité des pratiques vivantes. Dans le même temps, ces motifs et traditions ont été réinterprétés par des diasporas, devenant des marqueurs identitaires pour des communautés éloignées de leurs territoires d’origine.
Aujourd’hui, une modernité renouvelée s’empare de ces répertoires culturels, en les replaçant
dans une dynamique de transmission et de dialogue plutôt que dans une logique de rupture ou de disparition. Dans l’exposition, nous mettons en avant des initiatives valorisant la transmission des savoirs. À travers ses films, Myriem Naji documente et partage des techniques artisanales pour les rendre accessibles au public. Amina Agueznay collabore avec des tisseuses pour créer un répertoire de signes intégré à son œuvre. Enfin, présenter des tatouages contemporains et des écritures actuelles en résonance avec des pratiques ancestrales permet d’illustrer la continuité et l’adaptabilité de ces traditions.
Quelle a été votre principale découverte lors de vos recherches sur cette exposition ?
La complémentarité ! Préparer une exposition avec plusieurs personnes ayant des parcours différents est un bonheur, car le travail des uns éclaire celui des autres. Les collections aussi dialoguent, celles du Mucem et du musée Yves Saint Laurent Marrakech. De plus, le Mucem apporte un regard neuf sur la constitution des collections, en intégrant l’Encyclopédie berbère créée par le couple d’archéologues Gabriel (1927–2002) et Henriette Camps (1928–2015).
Nous souhaitons également évoquer la fille de Mireille Morin-Barde (1916–2002), ethnographe ayant réalisé un travail remarquable de documentation sur les coiffes et parures amazighes dans les régions présahariennes du Maroc. L’entendre se remémorer les années où sa mère rédigeait son ouvrage principal, fruit d’une enquête complexe, a été particulièrement émouvant. Son témoignage reflète l’attachement de Mireille Morin-Barde aux femmes qu’elle a rencontrées sur le terrain, ainsi que la difficulté de les retrouver dans les années 1980, trente ans après ses premières recherches. Faute de pouvoir toujours recourir à la photographie, elle a privilégié le dessin et la peinture, travaillant en étroite collaboration avec ces femmes, dans une démarche que l’on qualifierait aujourd’hui de participative et empreinte d’une éthique anthropologique encore peu répandue à l’époque.
Ces échanges et rencontres, essentiels à toute recherche, sont aussi la matière vivante qui nourrit en profondeur le travail d’une exposition.

Depuis les premiers mythes, la matrice à partir de laquelle est pensée la naissance de la culture amazigh est féminine : l’exposition s’ouvrira sur les figures fondatrices des déesses mères, associées symboliquement à la figure, féconde et protectrice, du cercle. Le parcours explorera ces notions de seuils et de cercles protecteurs, qui sont au cœur de la culture amazigh et la structurent, puis s’attachera aux objets, aux surfaces, aux formes et aux signes dans lesquels elles viennent s’incarner de façon matérielle : signes abstraits, géométriques, mais aussi figuratifs (tortue, poisson, grenouille, épi de blé
ou œil, figure anthropomorphe, etc.). L’accent sera mis sur la dimension cyclique de la nature (la lune, le retour du printemps, les moissons) en lien avec les gestes et les savoir-faire des femmes (poterie, tissage, teinture au henné, vannerie, tatouage…) mais aussi ceux des hommes pratiquant traditionnellement l’orfèvrerie

Cette exposition sera également l’occasion de s’interroger sur le concept de « permanence berbère » et sur les transmissions et circulations contemporaines de ce matrimoine/patrimoine au sein de l’importante diaspora amazigh, dans le domaine de la création artistique comme dans les cultures
populaires. Sans omettre, par ailleurs, l’appréciation voire l’appropriation culturelle dont ce matrimoine/ patrimoine peut faire l’objet aujourd’hui.
Environ 150 objets et œuvres du XIXe siècle à nos jours, ainsi que quelques pièces archéologiques, seront présentés parmi lesquels des bijoux, céramiques, textiles, vanneries, sculptures, outils, photographies, vidéos, installations, archives appartenant principalement aux collections du musée Pierre Bergé des arts berbères de la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech et à celles du Mucem, mais aussi à des collections publiques et privées canariennes, marocaines et françaises, ainsi qu’à des artistes.